On le sait depuis le succès de ses Lettres de Russie en 1839, Custine est la lecture obligée de tout bon observateur du pouvoir russe et de sa diplomatie. Légitimiste parti étudier les vertus du régime absolutiste de Nicolas Ier, le marquis de Custine en revient convaincu par la supériorité de la monarchie limitée de Louis-Philippe. S’il a un style admirable, que l’on a comparé à Tocqueville, Custine n’en a pas la profondeur. Bien des parties de son ouvrage, dont on ne lit aujourd’hui que des extraits, ont vieilli.
Mais pour reprendre le mot fameux de George Kennan, « si ce n’est pas un très bon livre sur la Russie en 1839, c’est à coup sûr un livre excellent, sans doute le meilleur de tous, sur la Russie de Staline et un livre encore pas mauvais du tout sur celle de Brejnev et de Kossyguine ». Alors que dire de la Russie de Poutine ! Force est en effet de constater l’aspect souvent troublant des digressions de Custine. Le despotisme russe du premier XIXe siècle, avec le règne d’un tsar qui a commencé par la répression sévère d’une insurrection libérale, celle des décabristes en 1825, ressemble étrangement au pouvoir russe actuel.
Des parallèles frappants avec l’actualité presque deux cents ans plus tard
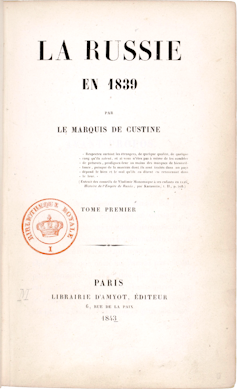
Fouillé par des douaniers soupçonneux, surveillé dans toutes ses visites, Custine étouffe dans cette « oppression déguisée en amour de l’ordre ». L’aubergiste de Lübeck l’avait prévenu contre un pays « que l’on quitte avec tant de joie et où l’on retourne avec tant de regret ». Bien sûr, Custine est injuste : il n’aime pas le paysage russe, trouve fade l’architecture néo-classique, et, catholique convaincu, réserve des flèches acérées à l’Église orthodoxe. Mais il diagnostique avec précision le principe actif du régime russe : l’absence de liberté y façonne toute l’organisation sociale et jusqu’à la psychologie des individus.
La Russie est une société où « nul bonheur n’est possible parce qu’il y manque la liberté ». Custine fustige le goût généralisé du mensonge : « le régime ne résisterait pas à vingt ans de libre communication avec l’Occident », « qu’on accorde pendant vingt-quatre heures la liberté de presse à la Russie, ce que vous apprendrez vous fera reculer d’horreur ». Il moque ces « physionomies prudentes dont l’expression peu franche fait trouver vide la société elle-même », un « pays où tout homme en naissant fait l’apprentissage de la discrétion ».
Mais Custine décrit une relation avec la Russie qui, de manière troublante, semble souvent correspondre à la réalité d’aujourd’hui. Ainsi de l’impérialisme d’un État qui « ne peut vivre que de conquêtes » et d’une nation russe qui « expie d’avance chez elle, par une soumission avilissante, l’espoir d’exercer la tyrannie chez les autres ». À l’époque, le sujet est la Pologne, pays catholique et monarchie constitutionnelle dont l’insurrection en 1830 a été sévèrement châtiée, mais on voit bien le parallèle avec l’Ukraine.

Ainsi du rapport à la vérité, avec ces lignes étonnantes quand on les relit actuellement, à l’heure de la guerre hybride menée contre les sociétés occidentales :
« S’il se trouve parmi les Russes de meilleurs diplomates que chez les peuples les plus avancés en civilisation, c’est que nos journaux les avertissent de tout ce qui se passe et se projette chez nous, et qu’au lieu de leur déguiser nos faiblesses avec prudence, nous les leur révélons avec passion tous les matins […] Nous marchons au grand jour, ils avancent à couvert : la partie n’est pas égale. »
Au sujet d’un naufrage lors duquel de nombreux Russes ont trouvé la mort mais dont les journaux ont eu ordre de ne pas parler, Custine s’étonne du silence de la population et du contraste avec la France de 1839 : dans notre pays, « que de journaux diraient, et que de voix répéteraient, que la police ne fait jamais son devoir, que les bateaux sont mauvais, les bateliers avides, et que l’autorité, loin de remédier au danger, l’aggrave, soit par son insouciance, soit par sa cupidité… et alors les dates, les allusions, les citations abonderaient… Ici, rien ! »
Invariants culturels ou politiques ?
Il reste que la Russie a bien changé depuis le règne de Nicolas Ier. À l’époque déjà de son voyage, Custine n’a pas vu certains changements en cours comme l’industrialisation du pays, la naissance d’une classe moyenne, les progrès économiques et sociaux qui allaient aboutir, bien plus tard, à l’abolition du servage en 1861. Il a sans doute aussi été influencé par les contempteurs du pouvoir russe qu’étaient les milieux libéraux en exil. Si la Russie de 1839 était un peu différente de celle qu’a vue Custine, elle devrait d’autant plus n’avoir aucun rapport avec celle que nous connaissons en 2024 – urbaine, vieillissante, développée, transformée par deux guerres mondiales et soixante-dix ans de soviétisme… Et pourtant, le parallèle entre la société observée par Custine et celle de Poutine ne cesse de surprendre.
Faut-il incriminer un invariant culturel qui tiendrait à la nation russe elle-même ? C’est ce que suggère Custine : « Ce n’est pas d’aujourd’hui que les étrangers s’étonnent de l’amour de ce peuple pour son esclavage. » Dans cette vision des relations internationales, chère à Samuel Huntington, la politique étrangère de Moscou serait un reflet de sa civilisation, étroitement liée à la société russe elle-même, et dont le pouvoir poutinien serait l’expression.
Ce parallélisme alimente d’ailleurs le discours de tous ceux qui, des Putinverstehers allemands jusqu’aux divers courants pro-russes français, considèrent que l’on ne peut changer la Russie, qu’elle possède d’immuables « intérêts de sécurité », une conception du monde qui lui est propre et qu’il faut donc la prendre telle qu’elle est, chercher à la rassurer faute de la changer. Poutine peut disparaître, Moscou demeurera, avec sa géographie, son peuple, ses mœurs. Custine sera le meilleur des introducteurs à la Russie de 2039.
Une autre manière d’expliquer Custine est de se référer aux théories libérales des relations internationales. La diplomatie d’un État est celle de son régime politique : si la politique étrangère de la Russie n’a pas changé, c’est que son régime demeure autoritaire ou, pour reprendre les mots de Custine, despotique. Dans cette vision, l’impérialisme est le stade suprême de la tyrannie. Cette explication peut d’ailleurs renforcer l’hypothèse culturaliste, la Russie n’ayant connu que de brèves et incomplètes expériences démocratiques, comme la création de la Douma en 1905, le gouvernement provisoire de février 1917 et la décennie 1990.
Questions pour aujourd’hui
Quelles que soient les explications à donner à l’étrange prémonition du marquis de Custine, sa lecture n’incite pas à l’optimisme sur le conflit ukrainien et l’avenir des relations de la Russie et de l’Occident. Rejetant la liberté, choisissant la force, dénigrant la vérité, la politique étrangère de Moscou est, en 1839 comme aujourd’hui, en profond décalage avec la société européenne. Faut-il en conclure que seul un changement du régime russe modifiera sa diplomatie ? C’est ce que la lecture de Custine suggère, même si la tâche paraît aussi titanesque qu’incertaine.
Faut-il, au contraire, accepter de revenir sur notre goût pour la paix et la plus complète liberté face à un impérialisme décomplexé et une société russe qui ne changera pas ? Ce sont des transformations de fond dont on voit, avant même de les entreprendre, tous les risques et toutes les difficultés. Mais Custine, se souvenant de l’occupation de Paris en 1814, anticipant semble-t-il l’expansionnisme soviétique et peut-être les menées russes de demain, nous avait prévenus :
« Si nous étions destinés à souffrir l’ignominie d’une nouvelle invasion, le triomphe des vainqueurs ne m’attesterait que les fautes des vaincus. »





